1 - Techniques d'exploration échographique de l'endomètre
2 - Endomètre au cours du cycle menstruel
3 - Pathologie fonctionnelle de l’endomètre
4 - Pathologie organique de l’endomètre
| 1 - Techniques d’exploration échographique de l’endomètre |
- L’échographie endovaginale est l’examen de première intention dans l’exploration de l’endomètre.
- Nécessité d’une sonde de haute fréquence, 5 à 7,5 MHz. On privilégiera pour une bonne visualisation de l’utérus et de la cavité une sonde vaginale à large secteur (160 à 200°).
- L’endomètre est visible sous la forme d’une bande tissulaire centrale dont l’épaisseur et l’échogénicité croissent au cours du cycle menstruel.
- Son épaisseur se mesure en coupe sagittale perpendiculaire à la ligne cavitaire qui sépare les deux feuillets. Lorsque la cavité est distendue par du liquide, on additionne l’épaisseur de chaque feuillet mesuré séparément.
- L’épaisseur et l’échostructure de l’endomètre doivent être interprétées en fonction du cycle et du type de traitement hormonal suivi.
- L’hystérosonographie est un examencomplémentaire très intéressant dans l’étude de l’endomètre et de sa pathologie. L’injection dans la cavité d’une solution saline sous contrôle échographique permet de la distendre et fournit un contraste artificiel permettant de mieux visualiser l’endomètre.
- L’épaisseur
endométriale normale est de 4 à 8 mm en première partie
de cycle et de 8 à 14 mm en deuxième phase du cycle. Chez la femme
ménopausée, elle ne doit pas dépasser 5 mm en dehors de
tout traitement hormonal substitutif. Cette limite passe à 10 mm sous
hormonothérapie substitutive. Au-delà, on parlera d’hypertrophie
endométriale fonctionnelle ou organique.
Pendant la phase menstruelle, l’endomètre apparaît comme
un dédoublement de la ligne de vacuité. Pendant la phase proliférative,
son échostructure est hypoéchogène, elle devient hyperéchogène
en phase lutéale.
- On tiendra
compte de ces variations de l’échostructure
endométriale dans la programmation de l’examen de façon
à bénéficier du meilleur contraste échographique
:
¤ en fin de phase proliférative (J8-J13) en cas de suspicion de
polype (les polypes sont hyperéchogènes),
¤ en fin de cycle (J20-J28) en cas de suspicion d’hypertrophie
de l’endomètre, de malformations utérines ou à la
recherche du retentissement intra-cavitaire d’un myome utérin.
| 2 - Endomètre au cours du cycle menstruel |
L’endomètre
est très sensible aux variations hormonales. Sous l’influence de
l’œstradiol puis de la progestérone, l’endomètre
va subir les modifications qui vont lui permettre d’accueillir une éventuelle
grossesse. On décrit deux phases :
- une phase proliférative sous influence oestrogénique,
- une phase sécrétoire sous influence progestative. La progestérone
a un rôle de maturation qui ne peut s’exprimer que sur une muqueuse
d’épaisseur suffisante préalablement préparée
par les oestrogènes.
Il est primordial de parfaitement situer le contexte hormonal de la patiente avant de commencer toute échographie. En cas de pathologie, cela permettra d’émettre des hypothèses diagnostiques compatibles avec la période du cycle (suspicion de GEU, kyste fonctionnel…).
Période menstruelle
:
- Endomètre fin,
- Dédoublement de la ligne cavitaire (hématométrie),
- Images de caillots et de débris échogènes de muqueuse
(Ne pas les confondre avec des polypes).
Phase
proliférative :
- Ligne cavitaire linéaire (ligne de réflexion endométriale),

- L’endomètre apparaît comme deux bandes hypoéchogènes
de part et d’autres de la ligne de réflexion,
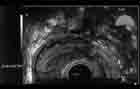
- Peut atteindre 8 à 10 mm en fin de phase proliférative.